Réchauffement climatique : La fièvre des océans et l'appel urgent à la protection de l'environnement
Ces dernières années, les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont continuellement atteint de nouveaux sommets, accélérant ainsi le processus du réchauffement climatique.
Un article publié dans la prestigieuse revue académique "Earth System Science Data" en juin 2023 a souligné que au cours de la dernière décennie, les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont atteint un pic historique, avec des émissions annuelles de dioxyde de carbone de 54 milliards de tonnes. Le professeur Piers Forster de l'Université de Leeds, l'un des auteurs, a insisté sur le fait que bien que le réchauffement climatique n'ait pas encore dépassé le seuil de 1,5°C fixé par l'Accord de Paris, à l'actuel rythme d'émissions de carbone, le budget carbone restant d'environ 250 milliards de tonnes de dioxyde de carbone sera probablement rapidement épuisé dans les prochaines années. L'équipe de recherche a appelé à l'adoption d'objectifs et de mesures de réduction plus stricts lors de la conférence COP28 en 2023. En mai 2023, un rapport publié par l'Organisation Météorologique Mondiale a indiqué qu'en raison des effets combinés des gaz à effet de serre et du phénomène El Niño, il est très probable que dans les cinq prochaines années (2023-2027), la température mondiale dépasse pour la première fois le seuil de 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels, avec au moins une année ayant une probabilité de 98 % de devenir l'année la plus chaude jamais enregistrée.
Le climat mondial est une communauté cohésive, où tout changement dans un facteur climatique peut avoir des impacts profonds sur d'autres éléments du climat. Traditionnellement, l'attention s'est concentrée sur la manière dont le réchauffement climatique déclenche des événements météorologiques extrêmes sur terre, tels que les vagues de chaleur, les sécheresses et les inondations. Cependant, grâce aux progrès de la technologie de surveillance climatique, il a été découvert que le réchauffement climatique induit également un phénomène appelé "fièvre océanique". Depuis 2023, les institutions météorologiques en Europe, aux États-Unis et dans d'autres régions ont observé des phénomènes de réchauffement anormal des eaux de surface des océans régionaux ou mondiaux. En juin 2023, des données publiées par le Met Office britannique ont montré que la température de l'eau de surface de l'Atlantique Nord en mai avait atteint le niveau le plus élevé depuis 1850, soit 1,25 °C au-dessus de la moyenne de la même période entre 1961 et 1990, notamment autour du Royaume-Uni et de l'Irlande où la température de l'eau de mer était supérieure de plus de 5 °C à la moyenne à long terme.
Actuellement, les scientifiques météorologiques britanniques ont classifié la vague de chaleur océanique de cette année comme étant de niveau extrême IV ou V. Un rapport de recherche publié en juin 2023 par l'Administration océanique et atmosphérique nationale (NOAA) des États-Unis a révélé un réchauffement significatif des eaux marines dans de nombreuses parties du monde depuis le début de 2023. Le 1er avril, la température de la surface des océans mondiaux a atteint un record de 21,1 °C, qui, bien qu'elle soit ensuite redescendue à 20,9 °C, restait tout de même supérieure de 0,2 °C au record de température le plus élevé de 2022. Le 11 juin, la température de l'eau de surface de l'Atlantique Nord a atteint 22,7 °C, la température la plus élevée jamais enregistrée pour cette région, avec des prévisions indiquant que la température de la surface marine continuera d'augmenter, atteignant son pic à la fin d'août ou de septembre.
En raison du réchauffement des océans, il est attendu que d'ici octobre, plus de la moitié des océans mondiaux connaîtront des vagues de chaleur marine. Le 14 juillet, le service Copernicus sur le changement climatique de l'Union européenne a détecté que la température de l'eau de mer dans l'Atlantique Nord et en Méditerranée avait battu des records sur plusieurs mois, avec des vagues de chaleur océanique dans la région méditerranéenne, et des températures de l'eau de mer le long de la côte sud de l'Espagne et le long de la côte nord-africaine dépassant les valeurs de référence moyennes de plus de 5°C, indiquant une escalade continue des vagues de chaleur océanique. En juillet 2023, NOAA a mesuré des températures de l'eau de mer de 36°C près de la côte sud-ouest de la Floride, aux États-Unis, la température la plus élevée enregistrée par le suivi satellitaire des températures océaniques depuis 1985.
Les observateurs météorologiques ont souligné que au cours des deux dernières semaines, la température de l'eau de mer ici était de 2 °C supérieure à la norme. La température de l'eau de mer n'est pas seulement un élément environnemental du système écologique marin, mais aussi une composante de base du système climatique terrestre. L'augmentation continue de la température de l'eau de mer a conduit à une augmentation de plus en plus fréquente des événements extrêmes liés aux eaux chaudes dans l'océan, posant une menace importante pour la santé des écosystèmes marins.
Les vagues de chaleur océaniques menacent les écosystèmes marins. Les vagues de chaleur océaniques, définies comme des événements extrêmes de températures élevées où les températures de surface de l'océan augmentent anormalement, durent généralement de plusieurs jours à plusieurs mois et peuvent s'étendre sur des milliers de kilomètres. Les vagues de chaleur océaniques endommagent directement les écosystèmes marins de manière brutale et simple, y compris en tuant directement les poissons, en forçant les poissons à migrer vers des eaux plus froides, en provoquant le blanchissement des coraux et potentiellement en conduisant à la désertification marine. Pour les écosystèmes marins, les vagues de chaleur océaniques sont une catastrophe complète.
Plus précisément, les dégâts causés par les vagues de chaleur océaniques se manifestent de deux manières suivantes :
1. **Forcer la vie marine tropicale à migrer vers des latitudes moyennes et élevées :**
Généralement, la région équatoriale est la zone la plus riche en ressources marines, avec une grande quantité d'herbes marines, de coraux et de mangroves, servant de paradis pour la plupart des créatures marines.
Cependant, au cours des 50 dernières années, la température de l'eau de mer à l'équateur a augmenté de 0,6 °C, forçant un grand nombre de créatures marines tropicales à migrer vers des latitudes moyennes et élevées plus fraîches pour se réfugier. Une étude publiée dans la revue Nature en avril 2019 a constaté que le réchauffement climatique a l'impact le plus significatif sur la vie marine, avec deux fois plus d'espèces contraintes de migrer dans l'océan qu'à terre, en particulier dans les eaux équatoriales. L'article estimait que actuellement, près d'un millier d'espèces de poissons et d'invertébrés fuient les eaux tropicales.
En août 2020, des scientifiques de l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère ont publié une recherche dans Nature, indiquant que les vagues de chaleur océanique provoquent un "déplacement thermique", avec des distances de déplacement allant de plusieurs dizaines à des milliers de kilomètres. Pour s'adapter à ces changements de température dans les océans, de nombreuses créatures marines doivent également se déplacer sur la même distance pour éviter les hautes températures, entraînant une "redistribution" de la vie marine. En mars 2022, des scientifiques australiens ont constaté une diminution du nombre d'espèces dans les océans tropicaux après avoir examiné près de 50 000 enregistrements de distribution de la vie marine depuis 1955, avec les latitudes 30°N et 20°S remplaçant la région équatoriale comme étant les zones les plus abondantes en espèces marines.
Non seulement l'environnement marin change, mais la chaîne alimentaire dans les eaux équatoriales évolue également. Le plancton joue un rôle important dans le complexe réseau de la chaîne alimentaire marine, mais ces dernières années, les scientifiques ont découvert que, en raison du réchauffement climatique, le nombre de plancton, représenté par les foraminifères, diminue rapidement dans les eaux équatoriales. Cela signifie qu'en termes de niveaux nutritionnels, les eaux équatoriales ne sont plus capables de soutenir une vie marine aussi riche qu'auparavant. Des environnements marins inadaptés et une diminution des ressources alimentaires accélèrent le processus de migration de la faune marine équatoriale. La migration massive de la vie marine tropicale déclenchera une série de réactions en chaîne, perturbant les écosystèmes marins stables formés au cours de millions d'années d'évolution géologique et biologique, voire entraînant leur effondrement progressif.
La migration d'un grand nombre d'espèces marines tropicales vers les écosystèmes marins subtropicaux signifie que de nombreuses espèces invasives pénétreront dans ces zones, et les nouvelles espèces prédatrices entreront en compétition intense pour la nourriture avec les espèces natives, entraînant le déclin ou même l'extinction de certaines espèces. Ce phénomène de collapsus écologique et d'extinction des espèces s'est produit lors des périodes géologiques permienne et trias.
2. **Causer la Mort d'un Grand Nombre de Créatures Marines :**
L'eau froide contient bien plus d'oxygène que l'eau chaude. L'augmentation continue de la température de l'eau de mer et la fréquence croissante des vagues de chaleur océaniques ces dernières années ont considérablement augmenté le phénomène d'hypoxie et de faible teneur en oxygène dans les eaux côtières. Les scientifiques soulignent qu'en raison de l'augmentation de la température de l'eau de mer, la teneur en oxygène dans l'océan a diminué de 2 % à 5 % au cours des 50 dernières années, entraînant la mort d'un grand nombre de poissons en raison de difficultés respiratoires. Certains grands poissons à forte consommation d'oxygène pourraient même devenir éteints.
En juin 2023, des milliers de kilomètres de poissons morts sont apparus dans les eaux près de la préfecture de Chumphon, dans le sud de la Thaïlande, et dans le golfe du Mexique aux États-Unis, causés par des poissons piégés dans des eaux peu profondes qui sont asphyxiés à cause des vagues de chaleur océanique. La mort massive des poissons affectera davantage les oiseaux marins qui s'alimentent avec eux. De 2013 à 2016, le réchauffement des eaux de surface du Pacifique au large de la côte ouest de l'Amérique du Nord a conduit à un événement tragique où environ un million d'oiseaux marins sont morts en raison du manque de nourriture. Les vagues de chaleur océanique entraînent également le blanchissement des coraux.
Les récifs coralliens, connus sous le nom de « forêts de la mer », fournissent des habitats, des lieux de recherche de nourriture et des zones de reproduction pour environ un quart de la vie marine, ce qui en fait l'un des écosystèmes les plus riches en biodiversité sur Terre. La formation des récifs coralliens ne peut être dissociée de la relation symbiotique entre les coraux et les zooxanthelles, qui s'apportent mutuellement des nutriments. Les zooxanthelles sont des algues très sensibles à la température. Lorsque la température de l'eau de mer augmente, leur photosynthèse s'affaiblit et elles produisent des radicaux libres d'oxygène nocifs pour les coraux. Pour se protéger, les coraux doivent expulser les zooxanthelles, rompant ainsi la relation symbiotique.
Sans zooxanthelles, les coraux reprennent progressivement leur couleur grise-blanc d'origine. Si les zooxanthelles ne reviennent pas pendant longtemps, les coraux perdront leur source de nutriments et finiront par mourir. C'est ce qu'on appelle le blanchissement des coraux. Actuellement, la Grande Barrière de Corail en Australie est celle qui est le plus sévèrement touchée par le phénomène de blanchissement. Ces dernières années, en raison du réchauffement climatique, la température de l'eau de mer près de la Grande Barrière de Corail a continué à augmenter, et entre 1998 et 2017, il y a eu au moins quatre événements de blanchissement massif des coraux.
Au début de 2020, l'Australie a connu des températures record, avec des incendies de forêt durant six mois sur terre et le plus sévère événement de blanchissement de corail jamais enregistré dans les océans, affectant environ un quart des récifs coralliens. Actuellement, plus de la moitié du Grand Récif de Corail a blanchi. Avec le réchauffement climatique, les événements de blanchissement des coraux deviendront plus fréquents et plus sévères. Les scientifiques ont découvert que depuis 1985, la fréquence du blanchissement mondial des coraux est passée d'une fois tous les 27 ans à une fois tous les quatre ans, et d'ici la fin du XXIe siècle, plus des trois quarts des coraux du monde sont susceptibles de blanchir ou de tomber malades. Le blanchissement et la mort des coraux entraîneront la perte de nombreux habitats, de zones de recherche de nourriture et de lieux de reproduction pour les poissons, affectant davantage le développement des populations de poissons.
Ces dernières années, la fréquence et l'étendue des vagues de chaleur océaniques ont continué d'augmenter et de s'étendre. En mars 2019, des chercheurs de l'Association Biologique Marine du Royaume-Uni ont publié un article scientifique dans la revue Nature Climate Change, indiquant que le nombre annuel moyen de jours avec des vagues de chaleur océaniques entre 1987 et 2016 a augmenté de 50 % par rapport à la période 1925-1954. De plus, les scientifiques ont également observé des phénomènes de vagues de chaleur océaniques dans les abysses. En mars 2023, des chercheurs de l'Administration Océanique et Atmosphérique Nationale ont publié une étude dans Nature Communications, montrant que les vagues de chaleur océaniques existent également dans les profondeurs marines. Grâce à la simulation de données observationnelles, il a été constaté que dans les zones entourant le plateau continental nord-américain, les vagues de chaleur océaniques en eaux profondes durent plus longtemps et peuvent présenter un signal de réchauffement plus fort que celui des eaux de surface.
L'augmentation de la fréquence et de l'étendue des vagues de chaleur océaniques signifie que les écosystèmes marins subiront des dommages plus importants à l'avenir. L'acidification des océans menace le développement des espèces marines. L'augmentation de la concentration de dioxyde de carbone atmosphérique provoque non seulement l'effet de serre et accélère le réchauffement climatique, mais entraîne également l'acidification des océans, menaçant la survie et la reproduction de la vie marine. L'océan échange constamment des gaz avec l'atmosphère terrestre, et presque tout gaz qui entre dans l'atmosphère peut se dissoudre dans l'eau de mer. En tant que composant important de l'atmosphère, le dioxyde de carbone peut également être absorbé par l'eau de mer. L'acidification des océans est essentiellement le phénomène où l'océan absorbe un excès de dioxyde de carbone, ce qui entraîne une augmentation des substances acides dans l'eau de mer et une diminution du pH.
Selon les estimations, environ un tiers du dioxyde de carbone émis par les humains dans l'atmosphère est absorbé par l'océan. À mesure que la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère continue d'augmenter, le taux d'absorption et de dissolution s'intensifie également. Actuellement, l'océan absorbe 1 million de tonnes de dioxyde de carbone par heure, ce qui signifie que l'acidification des océans s'accélère.
La recherche scientifique a découvert que, en raison des émissions excessives de dioxyde de carbone par les humains au cours des deux derniers siècles, la valeur de pH des océans mondiaux est passée de 8,2 à 8,1, augmentant ainsi l'acidité réelle de l'eau de mer d'environ 30 %. Selon le taux actuel d'émissions de dioxyde de carbone par les humains, d'ici la fin du XXIe siècle, le pH des eaux de surface des océans mondiaux pourrait chuter à 7,8, rendant l'acidité de l'eau de mer 150 % plus élevée qu'en 1800. En 2003, le terme « acidification des océans » est apparu pour la première fois dans la prestigieuse revue académique Nature. En 2005, les scientifiques ont indiqué qu'il y avait 55 millions d'années, un événement de disparition massive dans les océans était survenu en raison de l'acidification des océans, avec une estimation de 4,5 billions de tonnes de dioxyde de carbone dissoutes dans l'océan, après quoi il a fallu 100 000 ans à l'océan pour retrouver progressivement des niveaux normaux. En mars 2012, un article publié dans la revue Science a soutenu que la Terre connaît actuellement le processus d'acidification des océans le plus rapide des 300 derniers millions d'années, mettant de nombreuses espèces marines en crise de survie.
En avril 2015, une étude publiée dans la revue américaine Science a souligné que il y a 250 millions d'années, des éruptions volcaniques violentes en Sibérie ont libéré une grande quantité de dioxyde de carbone, provoquant une baisse rapide du pH de l'eau de mer au cours des 60 000 années suivantes, entraînant la mort d'un grand nombre d'organismes marins fortement calcifiés. Les scientifiques estiment que cet événement d'acidification océanique a finalement conduit à l'extinction de 90 % de la vie marine et plus de 60 % de la vie terrestre. L'étude a également indiqué qu'au cours de l'événement d'extinction massive survenu il y a 250 millions d'années, la quantité de dioxyde de carbone rejetée dans l'atmosphère chaque année n'était d'environ 2,4 milliards de tonnes, tandis qu'actuellement, les humains rejettent environ 35 milliards de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère chaque année, dépassant largement les émissions de la période d'extinction massive.
L'acidification des océans affecte gravement la croissance et la reproduction normales de la vie marine, menaçant la survie et le développement des espèces. D'une part, l'acidification des océans menace et inhibe la survie des organismes calcifieurs. L'acidification des océans entraîne une diminution continue des ions carbonates dans l'océan, qui sont des matériaux importants pour de nombreux organismes marins (comme les crabes, les palourdes, les coraux, etc.) pour former leurs coquilles.
L'acidification des océans menacera gravement la croissance et le développement de ces organismes calcifieurs. De plus, l'eau de mer acidifiée peut dissoudre directement certains organismes marins. Les mollusques constituent une source alimentaire importante pour les saumons, et les scientifiques prédisent que d'ici 2030, l'eau de mer acidifiée aura un effet corrosif sur les mollusques marins, entraînant leur réduction ou leur disparition dans certaines zones marines, affectant ainsi davantage les populations de saumons.
D'autre part, l'acidification des océans endommage également les systèmes sensoriels des poissons. Les systèmes sensoriels tels que l'odorat, l'ouïe et la vue aident les poissons marins à chercher efficacement de la nourriture, à trouver des habitats sûrs et à éviter les prédateurs. Une fois endommagés, cela menacera directement la survie des poissons. En juin 2011, des chercheurs de l'Université de Bristol au Royaume-Uni ont incubé des œufs de poisson-clown dans de l'eau de mer avec quatre différentes concentrations de dioxyde de carbone. Après des recherches comparatives, il a été constaté que les jeunes poissons éclos dans de l'eau de mer contenant une haute concentration de dioxyde de carbone réagissaient très lentement aux sons des prédateurs.
Cela signifie que dans une eau de mer acide, la sensibilité auditive des jeunes poissons diminue significativement. En mars 2014, une étude publiée dans Experimental Biology a découvert que de fortes concentrations de dioxyde de carbone dans l'eau de mer peuvent interférer avec divers types d'acide gamma-aminobutyrique dans les cellules nerveuses des poissons, réduisant leurs capacités visuelles et motrices, ce qui finit par rendre difficile pour eux de chercher de la nourriture ou d'éviter les prédateurs. En juillet 2018, une étude publiée dans Nature Climate Change a trouvé que l'acidification des océans peut entraîner la perte du sens de l'odorat chez les poissons, perturber leur système nerveux central et réduire la capacité de traitement de l'information par le cerveau.
En plus du préjudice direct causé aux espèces marines, l'acidification des océans peut encore amplifier les effets négatifs des polluants et des toxines marines. Des recherches ont montré que l'acidification des océans peut continuer d'augmenter la biodisponibilité des métaux lourds tels que le mercure, le plomb, le fer, le cuivre et le zinc, ce qui signifie que ces métaux lourds peuvent être plus facilement absorbés par les organismes marins et s'accumuler plus facilement chez ces organismes. Finalement, ces polluants seront transférés vers des organismes supérieurs via la chaîne alimentaire, menaçant leur santé. De plus, l'acidification des océans peut également modifier l'abondance et la composition chimique des algues nuisibles, permettant à ces toxines de se transférer vers les mollusques, produisant des toxines paralytiques et neurotoxiques, menaçant finalement la santé humaine.
Efforts mondiaux pour protéger la biodiversité marine Actuellement, la température moyenne des océans mondiaux a augmenté d'environ 0,9 °C par rapport au XXe siècle et de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Les dix dernières années ont été la décennie la plus chaude jamais enregistrée pour les températures océaniques. Le phénomène El Niño s'est formé en 2023, et les scientifiques prévoient qu'au cours des prochains mois, la température de surface des océans augmentera rapidement de 0,2 à 0,25 °C. Cela signifie que les écosystèmes marins feront face à des menaces de hautes températures plus sévères à l'avenir, et que la faune marine rencontrera de plus grands défis pour sa survie. Face à la crise écologique marine de plus en plus grave, les pays du monde entier agissent également activement pour protéger les écosystèmes marins. Le 19 décembre 2022, lors de la deuxième phase de la 15e Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique, le "Cadre mondial sur la biodiversité de Kunming-Montréal" a été adopté. Ce cadre a fixé l'objectif de « 30x30 », visant à protéger au moins 30 % des terres et des océans du monde d'ici 2030.
Pour garantir une mise en œuvre fluide de l'accord, le contenu de celui-ci a également établi des garanties financières claires et solides. Ce cadre guidera la communauté internationale à travailler ensemble pour protéger la biodiversité et s'efforcer d'atteindre l'objectif ambitieux de coexistence harmonieuse entre les humains et la nature d'ici 2050. Au cours des dernières décennies, un grand nombre d'activités maritimes, d'exploitation minière des fonds marins et de pêche en haute mer ont été menées dans les eaux internationales. Bien qu'il existe des institutions internationales régulant ces activités, le manque de communication et de coordination nécessaires entre les différentes institutions a conduit à un état fragmenté de la surveillance écologique et de la protection des hautes mers, n'arrivant pas à freiner efficacement la pollution environnementale marine et la perte de biodiversité.
En juin 2023, les Nations Unies ont adopté l'« Accord relatif à la conservation et à l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones situées au-delà des juridictions nationales en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. » Cet « Accord » propose de nouveaux mécanismes et contenus pour les évaluations environnementales maritimes, le transfert de technologie maritime, le partage des avantages issus des ressources génétiques marines, et les aires marines protégées. Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a souligné que cet « Accord » est crucial pour faire face aux menaces telles que le changement climatique, la surpêche, l'acidification des océans et la pollution marine, garantir le développement durable et l’utilisation de plus des deux tiers des océans mondiaux, et revêt une importance historique pour la protection de la biodiversité marine.


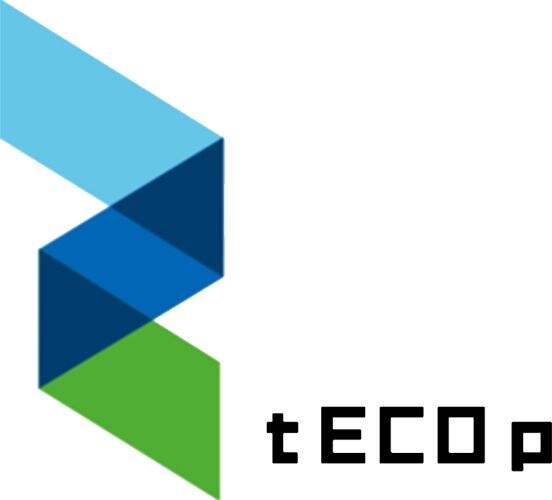
 EN
EN
 FR
FR
 DE
DE
 IT
IT
 AR
AR
 HR
HR
 DA
DA
 NL
NL
 FI
FI
 HI
HI
 JA
JA
 KO
KO
 PT
PT
 RU
RU
 ES
ES
 SV
SV
 TL
TL
 IW
IW
 ID
ID
 SR
SR
 UK
UK
 VI
VI
 HU
HU
 TH
TH
 TR
TR
 FA
FA
 AF
AF
 MS
MS
 GA
GA
 CY
CY
 AZ
AZ
 BN
BN
 KM
KM
 LO
LO
 LA
LA
 MR
MR
 NE
NE
 MY
MY
 KK
KK
 UZ
UZ
